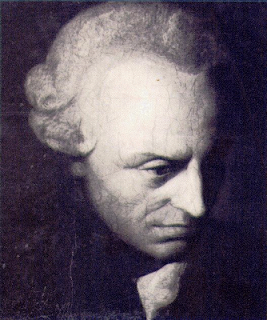L’histoire ne s’écrit pas au futur. Et le présent qu’ont vécu les acteurs de l’histoire, nous disent Charles Péguy, Henri-Irénée Marrou et Raymond Aron, n’était pas seulement du « passé pour plus tard ». A un moment donné, un choix s’est opéré entre tous les possibles. Bien sûr, ce choix n’était pas entièrement dû au hasard… On ne sort jamais d’une des apories de la raison explicitée par Kant dans sa Critique de la Raison pure. Soit tout arrive nécessairement, et on ne comprend pas comment du nouveau peut advenir, soit nous sommes absolument libres, et à ce moment là il faut renoncer à expliquer nos actions. Raymond Aron indiquait une autre piste, dans sa thèse sur la Philosophie critique de l’Histoire : l’événement jaillit, surprend (que l’on songe aujourd’hui à l’effondrement du communisme soviétique en 1989-1991), soit parce que l’ensemble de ses déterminants est trop complexe, qu’il outrepasse nos possibilités de connaissances (seul Dieu en ce sens, parce qu’omniscient, peut prévoir), soit parce qu’il y a de la contingence, du hasard, de l’indéterminé, de la liberté dans le réel… La célèbre définition du hasard que donne le grand philosophe et mathématicien français Cournot, au XIXe siècle, rend bien compte de cette indécision, quand il définit le hasard comme « la rencontre indéterminée de deux déterminismes ». Lui-même n’exclut pas que Dieu connaisse la date et les circonstances de la rencontre…
Pour l’historien, tout cela revient au même : la réalité historique est plus complexe, plus foisonnante, plus buissonnante que le récit, toujours simplifié, que nous en faisons. Cela frappe à mort toute lecture simple de l’histoire, et donc toute prévision infaillible tiré des études historiques, ainsi que toute tentative de tirer d’incontestables et univoques « leçons de l’Histoire ». C’est une des conséquences, entre mille, de la finitude humaine.
Cela dit, pour agir aujourd’hui, pour nous situer, pour juger les différents choix, les différentes mesures politiques que l’on nous propose, nous devons avoir une vision générale de l’évolution de nos sociétés, et surtout nous sommes obligés de nous faire une idée des conséquences des actions présentes. Et la connaissance du passé peut nous aider dans ce travail, même si elle ne peut en aucun cas nous préserver de l’erreur. Koselleck, je crois, distingue « l’espace d’expérience » et « l’horizon d’attente ». L’histoire de l’humanité, c’est notre espace d’expérience collective, quand bien même nous n’arrivons à en assimiler qu’une partie, elle-même filtrée par bien des médiations.
Je prends l’exemple du communisme : je crois que l’histoire du communisme est dans doute ce qu’il y a de plus instructif pour comprendre ce qu’est le phénomène idéologique, et pour saisir les limites du volontarisme politique, limites que l’on ne franchit qu’au prix d’un déchaînement de violence. Je pense inversement que l’histoire de la construction européenne, si on la débarrasse de ses mythes (un « enthousiasme des peuples » qui aurait disparu et dont on cherche vainement la trace, le projet étant plutôt un projet des élites politiques et administratives), tout comme l’histoire récente de la République sud-africaine, sont utiles quand on réfléchit sur les modalités de construction de la paix internationale ou de la paix civile. Nous devons prendre le risque, parfois, de chercher à nous construire, chacun d’entre nous, une sagesse politique personnelle au travers de l’étude de l’histoire.
Je pense aussi que l’histoire économique et sociale nous donne un recul des plus utiles pour saisir ce que nous pouvons attendre des politiques économiques et sociales que nous menons, et pour percevoir les évolutions de fond qui travaillent nos sociétés – par exemple, l’ampleur des mutations des années 1960 et 1970.
J’irai plus loin : le jeu des pronostics, la tentative d’analyser à chaud l’actualité, d’essayer de dégager les différents possibles, est un jeu où l’on gagne à tout coup : si nos pronostics sont justes, nous pouvons intervenir efficacement, en fonction bien sûr de nos valeurs. S’ils sont erronés, alors c’est que nous n’avions pas pris en compte tel ou tel aspect de la réalité. Nous y gagnons alors de pouvoir compléter notre vision du réel.